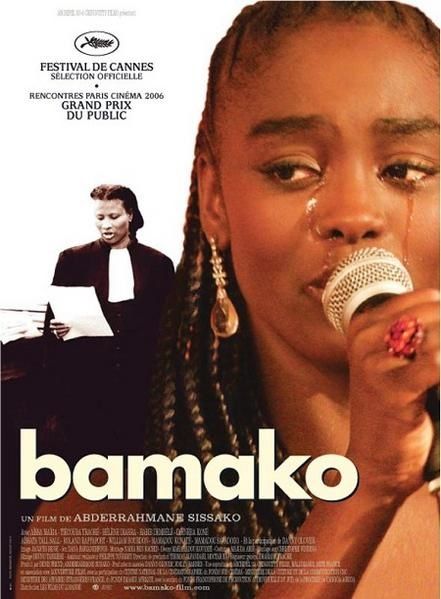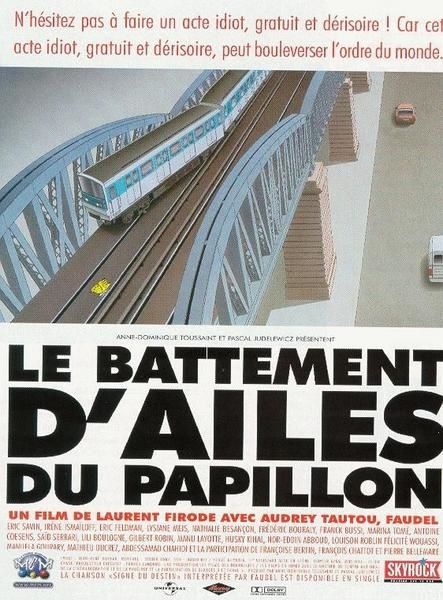Je n’ai rien de spécial à marquer, mais j’ai allumé l’ordinateur. Déjà, c’est dur de taper les bonnes touches, je me trompe tout le temps, comme je suis un peu, beaucoup, bourré. Je pense à quelque chose que je pourrais dire et rien ne me vient à l’esprit, rien qui ne se formule assez facilement en mots.. Rien, sinon ceci : je crois comprendre, Fred, ce que tu appelles par « interaction ».
Se laisser aller aux interactions, vouloir et aimer les interactions. C’est bien la grammaire des interactions de notre cher Goffman, mais il n’est pas question, enfin pas tout à fait, disons que ça se déporte ailleurs, de prescience des interactions, et donc de jeu sans risque, de jeu cynique. C’est juste faire aller les interactions et être à leur écoute, les guidant, ou croyant les guider, mais sans aucune prescience. Ce n’est peut-être pas qu’on ne pourrait pré-savoir ce qui va arriver, c’est qu’on se place au sein de l’interaction, une place à partir de laquelle on ne sait pas trop ce qui va arriver, même si, en fait, ce qui va arriver se détermine au sein nombre des possibles extrêmement réduit et la confiance est trouvée dans ce savoir du non-danger (mais s’il y avait danger, on le saurait, et la confiance serait trouvée dans ce savoir). On ne sait pas ce qui va arriver, mais on le sait quand même. On laisse aller, mais (ou car) on sait en gros où ça va atterrir. Quand tu me parles d’interactions, c’est en tant qu’acteur, ça va de soi. D’où que ce qui est fondamental, c’est moins ce savoir de l’interaction, que le plaisir pris à l’interaction, le plaisir à entrer dans l’interaction, à se laisser aller avec elle. Du coup, là où l’on croyait voir du cynisme, on ne voit pas de la naïveté, mais une ‘‘bonne volonté’’, c'est-à-dire c’est la « naïveté » qui se renverse en quelque chose de positif, et l’interaction, chose purement formelle, prend de l’épaisseur. Autrement dit, peu importe le résultat, c’est le procès qui importe. Le moment que l’on passe, ce que nous dit l’autre, etc. C’est aussi là où la notion d’information prend de l’importance et se dégage de tout cynisme. Dans ces moments-là, on voit les autres effectivement comme des égaux, et non comme des gens engagés dans des processus dont on connaît déjà plus ou moins (mais ce plus ou moins n’a aucune importance) le déroulement et la fin. Faire partie de ce déroulement, peut-être mène à subir cette fin comme tout à fait contingente alors qu’elle était parfaitement déterminée, mais en tous les cas nous fait faire partie d’une communauté dynamique, qui ignore a priori sa fin, qui se préoccupe de son déroulement plus que de sa fin, celle-ci apparaissant comme liée à celui-ci, et donc seulement indirectement à nous-mêmes.
La fin. Ça c’est un truc caractéristique chez les cyniques et autres critiques. On connaît déjà la fin. Les gens auxquels les critiques et leurs ennemis cyniques s’opposent ne connaissent pas la fin, et, s’il leur arrive de se poser la question, ne s’en préoccupent pas beaucoup. Les uns méprisent les autres parce que ceux-ci méconnaissent, « font semblent » ou « exprès » de ne pas la connaître, alors qu’elle est connaissable, la fin, et les autres sont indifférents aux uns parce que ceux-ci méconnaissent le déroulement, et ne lui accordent aucune importance alors que lui seul importe. Dans les termes de vie et de mort, on pourrait dire que pour les uns seule la fin importe, et que pour les autres seul ce qui s’est déroulé entre la naissance et la mort importe. Ceux-là semblent humains, pour ne pas dire « humanistes », alors que ceux-là voient dans cet « humain » une abominable obéissance, soumission, aux déterminismes qui de tout temps ont soumis les humains.
C’est pour cela que c’est ‘‘marrant’’ que tu me parles sans cesse d’interaction. Parce que c’est moins qui suis censé connaître Goffman. Parce que ça pose la question de l’utilité de Goffman ‘‘pour la vie’’. Goffman et d’autres, les plus anciens (Durkheim notamment) en premier. Parce que tu sous-entends que nous sommes, « évidemment », des acteurs sociaux. Point de vue qui méprise, ou est indifférent à leur égard, les non-acteurs, les observateurs, tout en intégrant leur rôle, c’est ce qui intéressant, d’une manière certaine. En sociologie, Dubet et Martuccelli ont parlé de « désinstitutionalisation », manière, je crois, de rendre palpable, par « lapsus » (je ne sais pas dire autrement, désolé), le fait que l’on se sent plus proche de nos contemporains, et concrètement des gens que l’on connaît, que des anciens et de ceux que l’on ne connaît pas, et que, en lisant Durkheim, on imagine aisément que ce qu’il dit s’applique sans doute à ses contemporains, mais que, tout de même, les nôtres sont différents. Il n’en est rien, bien évidemment, c’est juste la place que le sociologue se donne et le regard qu’il porte, qui changent. Dubet et Martuccelli disent que l’expérience propre à chacun importe sur toutes autres choses, mais c’est qu’ils en font partie, et intègrent leur propre expérience dans leur dire, et aussi ne font pas de différence entre leur expérience et celle de leurs contemporains, quand Durkheim, peut-être, s’extrayait de fait des observations (ou des imaginations ?) qu’il pouvait faire. Bref, pour une pointe de raccourci : on reconnaît bien des sociologues cools, conviviaux, de l’ère Jospin.
C’est dingue, j’ai quand même mieux à faire qu’écrire ces lignes, non ? Dormir, par exemple. N’empêche que ça me ‘‘traumatise’’, ça. Il ne s’agit pas d’être au-dessus du social, mais en dehors. On imagine le reproche qui peut être fait, à commencer par celui de ne rien comprendre, mais en même temps, si personne n’est en dehors, qui mettra le doigt sur les déterminismes que les acteurs, engagés, ne voient pas ? Même si, encore, ces acteurs revendiqueront le savoir de ce qui les détermine, pour autant que ne pas être compris, rester en deçà de la finalité, du tout, soit une nécessité pour les acteurs, car c’est ce qui donne du goût au jeu, c’est ce qui institue le ‘‘monde de la vie’’. De la même manière qu’à l’adolescent acharné à dévoiler les fins, les adultes répondent : mais on s’en fout, let it be. Et si rien, en effet, ne vient remettre « it » en cause, aucune extériorité, on se demande bien pourquoi ne pas laisser aller, et se laisser aller, aux « dispositifs », comme disait l’autre, qui constituent le ‘‘monde de la vie’’. Ce n’est pas exactement l’idée d’un danger qui motive le chercheur, parce que là-dessus, celui-ci et les acteurs ne seraient pas d’accord (pour ceux-là, il est question de préservation, pour celui-ci déjà question de remise en cause, ce qui ne peut advenir que dans un second temps pour ceux-là), mais c’est plus généralement l’idée d’une extériorité déjà existante, ne serait-ce que théoriquement. Ce qui, soit dit en passant, s’agence très bien avec l’idée romantique de recherche d’un ailleurs.